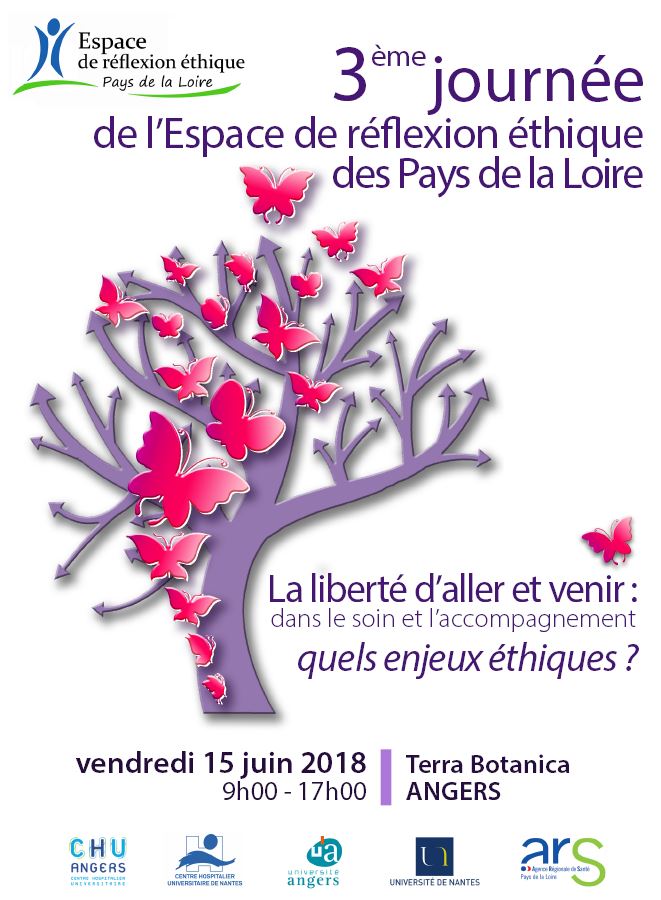
Mouvoir librement son corps, circuler librement dans un espace, entrer et sortir librement d’un établissement, choisir librement son lieu de vie, …autant de droits fondamentaux que toute personne peut légitimement revendiquer quelle que soit sa situation.
Pourtant, dans le champ sanitaire, social et médico-social, le respect de cette liberté se heurte fréquemment à des impératifs, des contraintes ou des limitations : mise en place de mesures de contention ou d’isolement, limitation de la libre circulation dans un établissement, absence d’accessibilité de l’espace pour les personnes en situation de handicap….
Qu’elles soient subies ou choisies, directes ou indirectes, physiques ou psycho-sociales, les différentes limitations de la liberté d’aller et venir des personnes accompagnées ou soignées méritent d’être interrogées, évaluées et discutées à travers le prisme de la réflexion éthique.
La thématique de la liberté d’aller et venir ne saurait être cantonnée aux seuls questionnements éthiques concernant le recours à la contention dans le domaine du soin ou de l’accompagnement. Une pluralité d’enjeux peut être pensée et articulée autour de cette liberté première :
– Comment concilier le respect de la liberté et l’impératif de protection des personnes, en particulier lorsque leurs capacités cognitives, leurs possibilités de communication et de discernement sont altérées ?
– Comment appréhender l’organisation de l’espace du soin en fonction des besoins, des capacités et des choix des personnes accompagnées ?
– Comment, en établissement médico-social, réconcilier les contraintes imposées par une organisation collective et les besoins singuliers des personnes accompagnées ?
– Quel équilibre trouver entre la prise en compte de la vulnérabilité des personnes et le respect de leur choix ?
– De quelle façon l’organisation spatiale du soin et de l’accompagnement révèle-t-elle quelque chose de notre rapport intime à l’espace et au temps ?
– Comment repenser l’accessibilité des personnes en situation de handicap ?
La 3ème journée de l’EREPL propose d’aborder la thématique transversale de la liberté d’aller et venir en la confrontant à différentes pratiques, à différents regards (médecine, philosophie, politique, histoire, droit, urbanisme, etc…) et à différents espaces de vie (établissement sanitaire, social ou médico-social, domicile, Ville, …)

A partir d’une prise de sang réalisée chez un homme et une femme qui désirent un enfant, un nouveau test génétique permettra bientôt de connaître, avant la grossesse, le risque pour le couple d’avoir un enfant atteint de certaines maladies génétiques graves (mucoviscidose, myopathies, maladies avec déficience intellectuelle,…).
Ce test génétique, déjà proposé dans d’autres pays, soulève de nombreuses questions médicales et éthiques : Quelles sont les maladies concernées par ce test ? Comment l’information sur ce test serait-elle donnée aux futurs parents ? Que faire lorsqu’une anomalie sera détectée ? Ce test est-il fiable ? Quel est son coût ? Serait-il remboursé ou bien à la charge des couples ? Est-ce envisageable et acceptable de faire disparaître totalement des maladies telles que la mucoviscidose ?
La soirée-débat organisée par l’EREPL et le CHU de Nantes sera l’occasion d’aborder toutes ces interrogations en présence de spécialistes qui répondront aux questions du public.
Programme :
Introduction du sujet
Dr Bertrand ISIDOR, praticien hospitalier, service de génétique médicale du CHU de Nantes – Présentation des résultats d’une enquête et d’une étude
Valérie BONNEAU, médecin généraliste à Rezé-les-Nantes
Eugénie HOARAU, médecin généraliste à St Nazaire
Table ronde (animée par Frédéric LOSSENT, journaliste)
- Dr Bertrand ISIDOR, praticien hospitalier, service de génétique médicale du CHU de Nantes
- Guy MINGUET, professeur de sociologie, Ecole des Mines de Nantes
- Mauro TURRINI, Data Santé, Université de Nantes
- Dr Miguel JEAN, praticien hospitalier, directeur de l’EREPL
- Dr Maud JOURDAIN, département de médecine générale, Université de Nantes


Entre pratiques médicales et rites funéraires, entre représentations et réalités, la place du corps défunt soulève toujours autant d’interrogations chez les professionnels du soin et dans le grand public. Au cours de cette soirée-débat organisée par l’EREPL, plusieurs acteurs issus de disciplines différentes (médecine, droit, sciences humaines) auront l’occasion d’échanger avec le public sur les enjeux éthiques autour du corps défunt. Ils aborderont des questionnements qui nous concernent tous : comment considérer le corps défunt ? Un objet ? Un sujet ? Comment respecter les choix de la personne ? Comment comprendre l’évolution et la diversité des normes sociales ? Pourquoi parler d’équité, de justice?
Intervenants de la table ronde :
- Magali BOUTEILLE-BRIGANT Maître de conférences en droit privé – Le Mans Université
- Sylvie CLASSE Ancienne cadre supérieure de santé au Centre Hospitalier du Haut-Anjou
- Dr Florence DECIRON-DEBIEUVRE Chef de service du SAMU 72 et responsable de la coordination pour les prélèvements d’organes et de tissus – Centre Hospitalier Le Mans
- Hervé GUILLEMAIN Professeur d’histoire contemporaine à l’Université du Mans
- Pr Clotilde ROUGE-MAILLART Médecin légiste – professeur de médecine légale et droit de la santé
Débat animé par Frédéric LOSSENT, journaliste




Les récentes évolutions juridiques encadrant l’accompagnement de la fin de vie en France (notamment la loi Léonetti-Claeys du 2 février 2016) suscitent des questions pratiques et éthiques récurrentes.
Comment penser, préparer, et encadrer cet ultime accompagnement ? Comment concilier le respect de l’autonomie des personnes âgées avec les impératifs d’organisation des soins ? Quels sont les forces et les limites des directives anticipées pour faire valoir les choix des personnes accompagnées ? Comment respecter la place des personnes de confiance, des familles, des proches, des aidants, dans l’accompagnement de la fin de vie ?
Autant de questions fondamentales qui justifient des espaces d’échanges interdisciplinaires pour confronter les points de vue et nourrir la réflexion et les évolutions à venir.
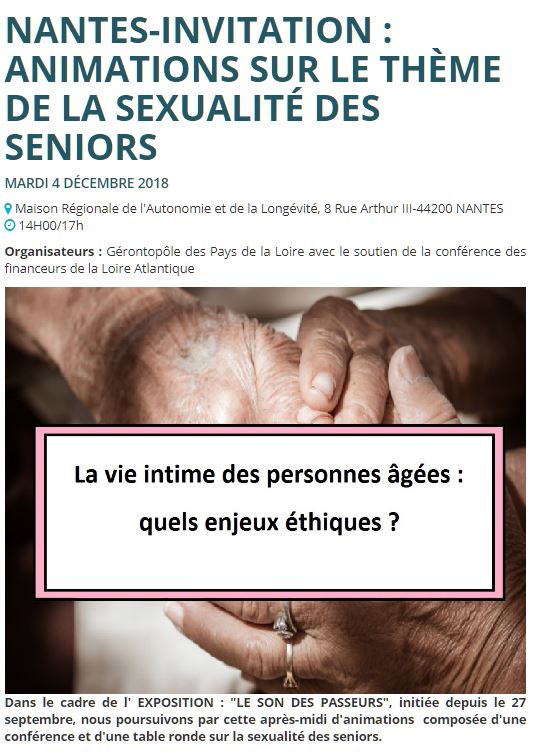


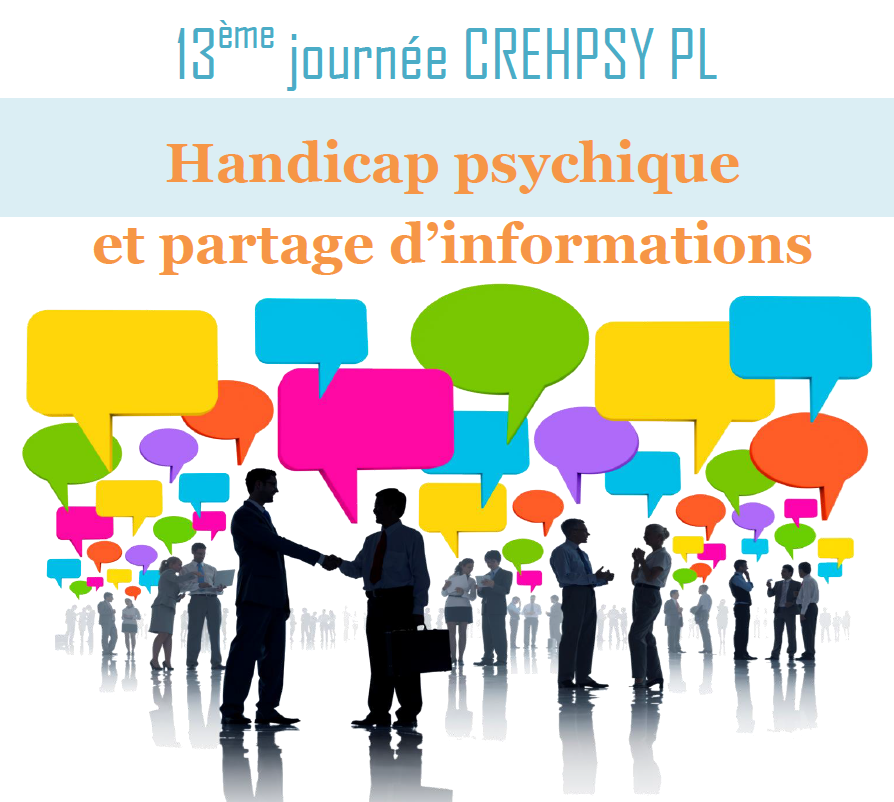
L’accompagnement des parcours de santé et de vie des personnes souffrant de troubles psychiques chroniques fait participer une grande pluralité d’acteurs, dont la complémentarité d’approches et de compétences nécessite des ajustements singuliers, et concertés. Cet accompagnement, diversifié, personnalisé, assuré la plupart du temps sur de longs mois, ou années, génère une multitude de données informatives, portant sur des registres différents (diagnostiques, thérapeutiques, cliniques, fonctionnels, subjectifs, concrets et factuels, portant sur la vie quotidienne, la dimension de la citoyenneté, la vie au travail, la vie dans un logement, le parcours de rétablissement, la poursuite et l’avancée du projet de vie etc.) Bien souvent, la vie des personnes souffrant de ces troubles devient ainsi une sorte d’espace transparent, conquis, où les professionnels, animés des meilleures intentions, et pour agir utilement, s’approprient ces données, sont amenés à les partager, à les traiter, empiétant inévitablement sur le champ du libre-arbitre et de la vie privée. Comment, dès lors, assurer une continuité du soin et de l’accompagnement tout en préservant la confidentialité des personnes accompagnées ? Comment décloisonner les pratiques, intégrer au maximum les familles et les aidants, favoriser le travail en équipe tout en protégeant les secrets des personnes accompagnées ? Jusqu’où les informations recueillies et transmises peuvent basculer vers le jugement de valeur ou induire des logiques de stigmatisation qui enferment la personne accompagnée dans des stéréotypes ? Au-delà des bonnes intentions des différents acteurs, comment anticiper et appréhender les menaces générées par l’utilisation des dispositifs techniques ? Techniquement, il est sans doute, et d’abord, possible de limiter le champ des informations partagées à ce qui est indispensable à chacun pour l’exercice de sa fonction propre auprès du bénéficiaire. Encore faudrait-il, maintenant, commencer ce travail contractuel d’explicitation. Mais cette première étape ne nous exonérera pas du travail de réflexion éthique : les principes peuvent être clairs, leur application ne pourra jamais l’être. Les réalités concrètes, le contexte relationnel, les singularités de la pathologie ou du caractère de la personne, la complexité objective de la situation ne pourront jamais autoriser une mise en œuvre mécanique des recommandations élaborées. Comment, dès lors garder le cap du respect du droit de la personne à rester maître de ce que l’on sait d’elle ? L’Espace Éthique Régional et le Centre Ressource Handicap Psychique des Pays de la Loire vous convient à explorer avec eux cette thématique, et, s’il est possible, à faire progresser les pratiques.






