
Le ministère de la Santé et de la Prévention, avec l’aide de l’Agence du Numérique en Santé, met à disposition un service en ligne pour recueillir les alertes sur des problèmes éthiques rencontrés dans l’usage d‘outils numériques de santé :
Message indiqué sur le site du ministère de la santé et de la prévention pour signaler un problème éthique lié à un outil numérique en santé : « Confidentialité et intégrité des données de santé, sécurité et transparence de leurs traitements informatiques, respect de l’information du patient, réduction des fractures numériques, mais également sobriété numérique et réduction de l’impact environnemental des systèmes d’information de santé : autant de principes éthiques qu’il nous faut encourager dans le développement des services et applications numériques de santé. Et c’est grâce à vos contributions que nous parviendrons à être plus efficaces dans cet objectif d’améliorer ces solutions numériques que vous utilisez au quotidien. Merci à vous ! Comment fonctionne le signalement ? Il suffit de répondre au questionnaire ci-dessous qui vous permet, en quelques minutes, de décrire la mauvaise expérience que vous avez vécue. Le questionnaire est complètement anonyme. Les réponses et traitements réalisés suite à vos signalements seront régulièrement publiés et accessibles depuis cette page. Ce service d’alerte ne concerne pas les anomalies techniques et bugs informatiques qui sont à remonter directement au fournisseur du service. »

Nous évoluons dans un monde qui nous dépasse. Un monde horizontal, instantané, complexe, où l’émotion prime sur la raison et le manichéisme, sur la nuance et le temps long.
Argumentaire du Dr. Aurélien Benoilid, Président du Forum Européen de Bioéthique :

Le Pr. Jean-François Delfraissy, Président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), souligne les enjeux de santé individuels et collectifs liés au récent vote de la loi sur l’immigration, mettant en avant la nécessité de préserver la fraternité et la solidarité pour le bien-être de tous.

Publication dans » the conservation » de l’article de Médecin de santé publique, École des hautes études en santé publique (EHESP) et de Professeur, docteur en médecine, tabacologue – Directeur général d’Unisanté, Université de Lausanne intitulé « Changer les mots pour changer le système de santé ? »
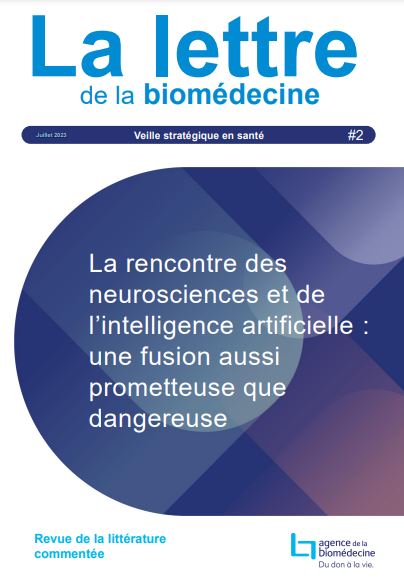
L’Agence de la Biomédecine publie sont deuxième numéro de La lettre de la biomédecine. Veille stratégique en santé. #2 La rencontre des neurosciences et de l’Intelligence artificielle : une fusion aussi bien prometteuse que dangereuse.
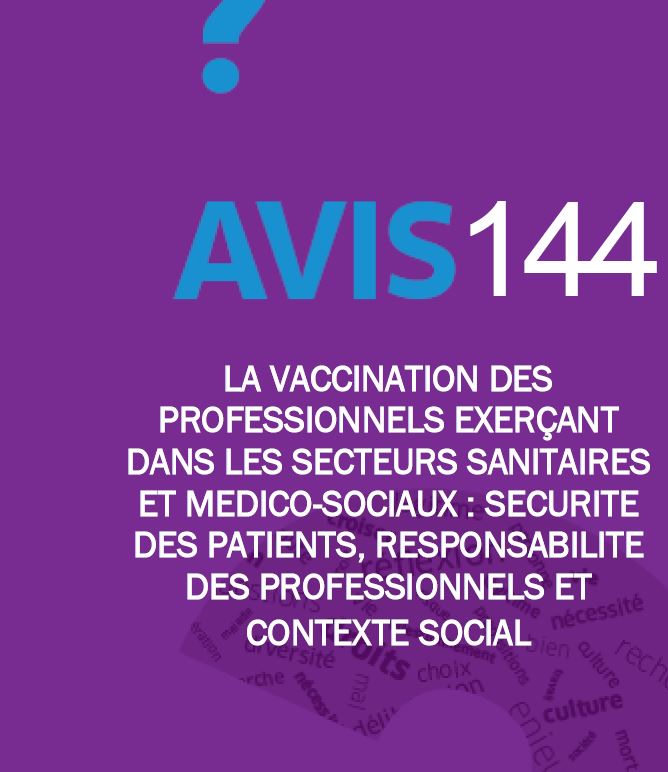
Le CCNE publie son avis 144 « La vaccination des professionnels exerçant dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux : sécurité des patients, responsabilité des professionnels et contexte social », en réponse à la saisine de François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Cette dernière demande à « connaître l’avis du CCNE sur la définition de critères permettant de justifier ou non de la mise en place d’une obligation vaccinale, au regard notamment d’une interrogation sur les valeurs, entre la liberté individuelle d’une part et le bénéfice collectif et l’intérêt général qui sous-tendent le contrat social induit par la vaccination. » Cette réflexion se situe trois ans après le début de la pandémie de Covid-19, alors que
le contexte épidémique est jugé favorable par Santé publique France et que la réintégration des soignants non vaccinés suspendus est effective depuis presque deux mois (15 mai), mais que les tensions des métiers du soin perdurent. Prenant en compte les enjeux historiques de l’adhésion ou non à la vaccination en France et les premiers enseignements de la crise sanitaire, le CCNE inscrit son travail dans un cadre prospectif, visant à guider les analyses et décisions de santé publique à venir.

L’égalité est un principe et une valeur de la République. Dans les faits, on constate toutefois des inégalités dans l’accès aux soins. Eclairer les aspects méconnus, invisibles ou paradoxaux qui y concourent constitue un enjeu de responsabilité individuelle et collective. Sur quels repères éthiques s’appuyer en pratique pour y remédier ?

Publication d’un article dans « the conservation » de Maître de conférences – praticien hospitalier, Université Sorbonne Paris Nord intitulé « De « Dr Google » à « Dr ChatGPT », quels sont les risques de l’autodiagnostic en ligne ? »







